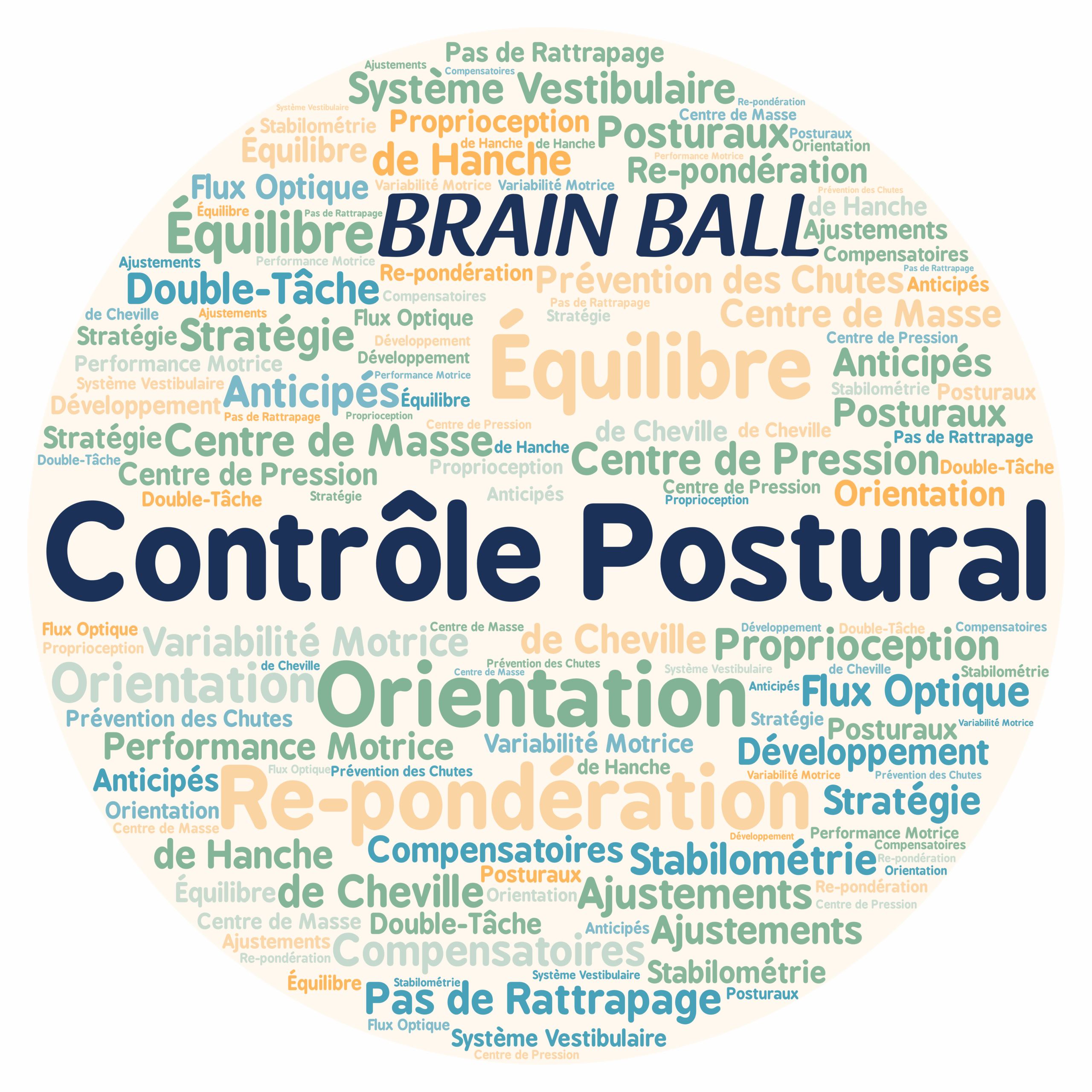Le contrôle postural regroupe l’ensemble des processus qui maintiennent l’orientation du corps dans l’espace et son équilibre face à la gravité et aux perturbations internes/externes (Horak, 2006). Il sert à la fois à stabiliser pour ne pas chuter et à préparer le mouvement via des ajustements anticipés. C’est une habileté complexe qui intègre des informations visuelles, vestibulaires et somatosensorielles, avec une re-pondération continue de la fiabilité de chaque canal selon le contexte (Peterka, 2002). Un bon contrôle postural se traduit par une dépense énergétique réduite, une meilleure efficacité motrice et une prévention des chutes chez l’enfant, l’adulte et la personne âgée.
Les deux fonctions clés du contrôle postural : orientation et équilibre
Les chercheurs distinguent deux objectifs complémentaires :
- l’orientation posturale : alignement actif tête-tronc-membres par rapport à la gravité, au support et à l’environnement visuel.
- l’équilibre postural : maintien du centre de masse dans la base de sustentation, malgré les perturbations.
Ces fonctions reposent sur des stratégies posturales (cheville, hanche, pas, prise d’appui des bras) sélectionnées selon l’amplitude et la direction de la perturbation, les contraintes de la tâche et les caractéristiques individuelles (Horak & Nashner, 1986; Maki & McIlroy, 1997).
Contrôle postural : une intégration sensorimotrice dynamique
Le contrôle postural s’appuie sur trois familles d’informations :
- Vision : repères, flux optique, stabilité du regard.
- Somatosensoriel : proprioception, pression plantaire, informations cutanées du support.
- Vestibulaire : accélérations et orientation gravitaire.
Le système nerveux réalise une intégration multisensorielle avec re-pondération : lorsque la vision est peu fiable (brouillard, pièce sombre), la proprioception et le vestibulaire prennent davantage de poids, et inversement (Peterka, 2002). Cette flexibilité explique pourquoi une personne peut rester stable sur sol ferme mais se déstabiliser sur mousse les yeux fermés.
Côté commande motrice, deux types d’ajustements coopèrent :
- Ajustements posturaux anticipés (APA) : activations pré-mouvement pour limiter le déplacement du centre de masse.
- Ajustements posturaux compensatoires : réponses réflexes et volontaires après perturbation, mobilisant stratégie cheville/hanche ou pas de rattrapage.
Développement et vieillissement du contrôle postural
Le développement du contrôle postural s’étale de la petite enfance à l’adolescence, avec des changements de stratégies (du contrôle segmentaire vers des coordinations tête-tronc intégrées) et une amélioration de la re-pondération sensorielle. Chez l’adolescent, la croissance rapide peut transitoirement perturber l’équilibre.
Avec l’avancée en âge, on observe typiquement une diminution de la sensibilité somatosensorielle/vestibulaire, un temps de réaction allongé, et une variabilité accrue du centre de pression. Pour autant, un entraînement ciblé (force, stratégies cheville/hanche, transitions, double-tâches) améliore la sécurité de marche et réduit le risque de chute (Sherrington et al., 2019).
Évaluer le contrôle postural : de la plate-forme à la double-tâche
En pratique, on combine mesures instrumentales et tests cliniques :
- Stabilométrie (plate-forme de force) : analyse du centre de pression (COP) en appui bipodal/monopodal, yeux ouverts/fermés, sur sol ferme ou mousse — on observe la surface et la vitesse de déplacement du COP.
- Tests cliniques fonctionnels : Timed Up and Go, Berg Balance Scale, appui unipodal chronométré, Star Excursion Balance Test.
- Épreuves de re-pondération : variations contrôlées de vision/support et double-tâches cognitives.
Entraîner le contrôle postural : principes et exemples
Un entraînement efficace suit quatre axes : spécificité (supports, vitesses, directions), progressivité (bipodal → unipodal → transitions dynamiques), variabilité (double-tâches, repères rythmiques, repères visuels) et transfert (gestes du quotidien, sport). Les pas de rattrapage et l’élargissement de la base en réponse à une poussée contrôlée constituent des apprentissages utiles (Maki & McIlroy, 1997).
Exemples :
- Séquences cheville-hanche avec perturbations antéro-postérieures puis médio-latérales, yeux ouverts/fermés.
- Appui unipodal + tâche cognitive (compter à rebours) pour travailler stabilité et attention.
- Balancement rythmique régulier au métronome pour calibrer amplitude et symétrie avant d’ajouter un déplacement ou un lancer-attraper.
Contrôle postural et performance : du quotidien au sport
Dans la vie courante, les double-tâches (marcher + parler, porter + regarder) sollicitent fortement le contrôle postural (Woollacott & Shumway-Cook, 2002).
En sport, la stabilité coexiste avec la vitesse, l’anticipation et le changement de direction. Les athlètes experts présentent souvent des ajustements anticipés plus précoces et spécifiques à la tâche, et une re-pondération plus efficace — à entraîner spécifiquement selon la discipline (Horak, 2006).
Pour aller plus loin :
-
Horak, F. B. (2006). Postural orientation and equilibrium: What do we need to know about neural control of balance to prevent falls? Age and Ageing, 35(Suppl 2), ii7–ii11. https://doi.org/10.1093/ageing/afl077
-
Horak, F. B., & Nashner, L. M. (1986). Central programming of postural movements: Adaptation to altered support-surface configurations. Journal of Neurophysiology, 55(6), 1369–1381. https://doi.org/10.1152/jn.1986.55.6.1369
-
Massion, J. (1994). Postural control system. Current Opinion in Neurobiology, 4(6), 877–887. https://doi.org/10.1016/0959-4388(94)90137-6
-
Peterka, R. J. (2002). Sensorimotor integration in human postural control. Journal of Neurophysiology, 88(3), 1097–1118. https://doi.org/10.1152/jn.2002.88.3.1097
-
Sherrington, C., Fairhall, N. J., Wallbank, G. K., Tiedemann, A., Michaleff, Z. A., Howard, K., Whitney, J., & Cumming, R. G. (2017). Exercise to prevent falls in older adults: An updated systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 51(24), 1750–1758. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096547
-
Woollacott, M. H., & Shumway-Cook, A. (2002). Attention and the control of posture and gait: A review of an emerging area of research. Gait & Posture, 16(1), 1–14. https://doi.org/10.1016/S0966-6362(01)00156-4
FAQ sur le contrôle postural
Le contrôle postural est-il surtout « réflexe » ?
Non. Les réflexes contribuent aux réponses compensatoires, mais le contrôle postural implique aussi des processus anticipés (APA), l’attention et la prise d’information (Massion, 1994). La stabilité résulte de la coordination entre capteurs, commande et contexte (Horak, 2006).
Les exercices d’équilibre suffisent-ils à prévenir les chutes ?
Ils sont nécessaires mais rarement suffisants. La prévention associe renforcement, mobilité, vitesse de réaction, pas de rattrapage et double-tâche, avec une progressivité adaptée (Sherrington et al., 2019).
Pourquoi entraîner le contrôle postural avec un métronome ou des repères rythmiques ?
Un repère rythmique sert d’indice (cue) temporel : il facilite le calage attentionnel, l’uniformisation de l’amplitude et la stabilité de cadence, donc la coordination, y compris en double-tâche (Woollacott & Shumway-Cook, 2002).
À quoi sert le balancement des bras dans la stabilité ?
Les bras agissent comme des contrepoids et élargissent artificiellement la base de sustentation lors des perturbations. En mouvement, ils améliorent le contrôle postural en réduisant le déplacement du centre de masse et en facilitant les pas de rattrapage.
Dans l’entraînement de l’équilibre et de la prévention des chutes (marche, exercices de stabilité, séances Brain Ball©…), autoriser un usage actif des bras est souvent plus pertinent que de les bloquer, surtout au début. Pour approfondir, vous pouvez consulter notre article dédié au rôle des bras dans la prévention des chutes.