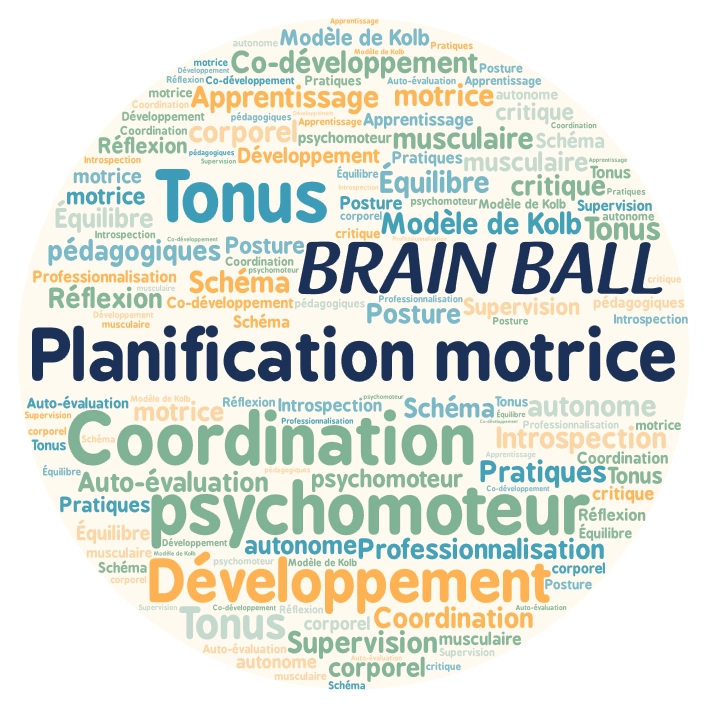Définition
La planification motrice désigne la capacité à organiser mentalement et à préparer une séquence de mouvements avant leur exécution. Elle implique l’anticipation des gestes nécessaires, leur ordre, leur intensité et leur durée. Ce processus repose sur l’intégration des informations sensorielles, la mobilisation de la mémoire motrice et l’adaptation en fonction du contexte.
La planification motrice est mobilisée dans des gestes simples (attraper un objet) comme dans des actions complexes (danser une chorégraphie, conduire un véhicule). Elle fait intervenir à la fois des mécanismes cognitifs et moteurs, ainsi qu’un dialogue constant entre le système nerveux central et les effecteurs musculaires.
Les mécanismes neurophysiologiques de la planification motrice
La planification motrice mobilise plusieurs régions cérébrales, notamment le cortex prémoteur, le cortex pariétal postérieur et les ganglions de la base. Ces structures permettent de :
- Déterminer la séquence des gestes
- Évaluer la position initiale du corps
- Anticiper la trajectoire et la force nécessaire
- Ajuster les mouvements en fonction du feedback sensoriel
Le cervelet joue également un rôle essentiel dans la précision et la coordination, tandis que les voies motrices assurent la transmission de l’information aux muscles.
Rôle de la planification motrice dans le développement psychomoteur
Chez l’enfant, la planification motrice se développe progressivement au fil des expériences motrices et sensorielles. Les activités de jeu, le sport, la manipulation d’objets ou encore les activités artistiques comme la danse ou la musique stimulent fortement cette compétence.
Un déficit de planification motrice peut se traduire par des gestes maladroits, une lenteur d’exécution ou des difficultés à organiser une tâche motrice complexe, comme s’habiller ou suivre un parcours moteur.
Planification motrice et troubles du développement
Certaines pathologies et troubles neurodéveloppementaux peuvent altérer la planification motrice, notamment :
- La dyspraxie développementale
- Les troubles du spectre de l’autisme
- Les séquelles d’atteintes neurologiques (traumatismes crâniens, AVC, paralysie cérébrale)
Dans ces cas, les difficultés concernent la conceptualisation, l’organisation et la réalisation des gestes, malgré des capacités physiques intactes.
Évaluation de cette compétence
Les professionnels de santé (psychomotriciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes) utilisent différents outils pour évaluer cette compétence :
- Observations cliniques lors d’activités dirigées
- Tests standardisés (parcours moteurs, tâches de manipulation d’objets, puzzles)
- Analyse des stratégies mises en place par le patient pour atteindre l’objectif
Ces évaluations permettent d’identifier les axes de travail et de concevoir des programmes de rééducation adaptés.
Stimuler et améliorer la planification motrice
L’entraînement à la planification motrice peut inclure :
- Exercices moteurs séquentiels : reproduire une série de mouvements dans un ordre précis
- Activités rythmiques : danser, jouer d’un instrument ou pratiquer des exercices en musique
- Parcours moteurs : intégrer obstacles, changements de direction et variations de vitesse
- Jonglage et coordination bilatérale : améliorer la communication inter-hémisphérique
La méthode Brain Ball utilise notamment des exercices ludiques et rythmés qui sollicitent simultanément les capacités sensorielles, motrices et cognitives, renforçant ainsi la planification motrice.
Les limites et débats
Si le concept est largement reconnu, certaines recherches débattent encore de la frontière entre planification motrice et contrôle moteur. Les interactions avec la perception, la mémoire de travail et l’attention complexifient l’analyse de cette fonction.
De plus, la mesure objective de la planification motrice reste un défi, les tests disponibles captant souvent un mélange de compétences motrices, cognitives et sensorielles.
Pour aller plus loin :
-
Gentilucci, M., & Dalla Volta, R. (2008). Spoken language and arm gestures are controlled by the same motor control system. Quarterly journal of experimental psychology (2006), 61(6), 944–957. https://doi.org/10.1080/17470210701625683
-
Sugden, D. A., & Chambers, M. E. (2003). Intervention in children with Developmental Coordination Disorder: the role of parents and teachers. The British journal of educational psychology, 73(Pt 4), 545–561. https://doi.org/10.1348/000709903322591235
FAQ sur la planification motrice
Qu’est-ce que la planification motrice ?
Pourquoi la planification motrice est-elle importante ?
Comment améliorer la planification motrice ?
Quels troubles peuvent affecter la planification motrice ?