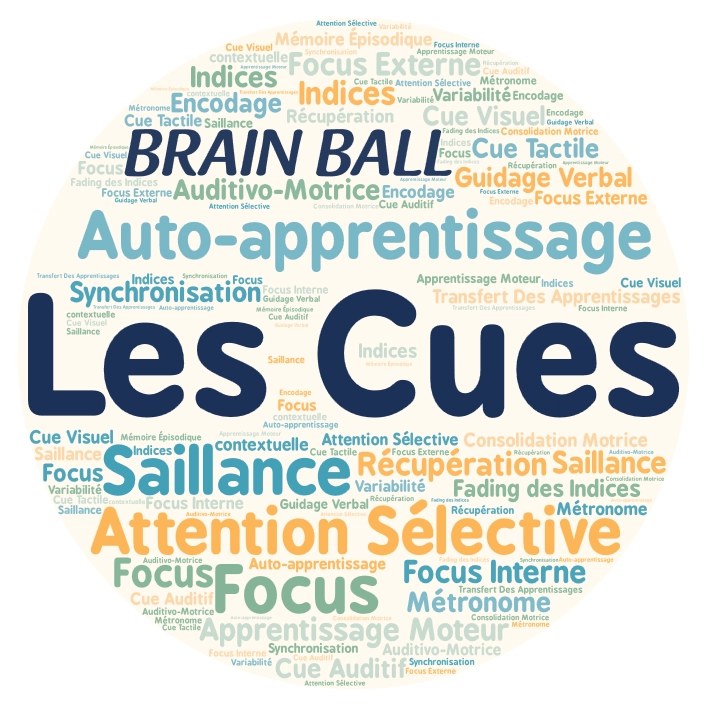Le Cue : de quoi parle-t-on en sciences de l’éducation ?
Un Cue (indice, signal ou repère) est une information saillante — visuelle, auditive, tactile ou verbale — qui oriente l’attention, déclenche une réponse ou contraint une action. Dans les recherches en apprentissage moteur, en neurosciences cognitives et en sciences de l’éducation, le Cue sert à guider la perception, à sélectionner ce qui compte dans l’environnement, à pré-activer une représentation (règle, geste, séquence) et à stabiliser la performance.
On distingue classiquement :
- les Cues externes, centrés sur l’effet du mouvement : dépose le ballon au fond du filet, vise la cible, rase la piste…
- les Cues internes, centrés sur le corps : engage les dorsaux, détends l’épaule, casse le poignet
- Des Cues temporels (ex. un métronome) et Cues contextuels (couleurs, marquages spatiaux) complètent l’arsenal pédagogique.
Pourquoi le Cue est central pour l’attention et la performance ?
Les Cues réduisent la charge attentionnelle en indiquant où porter le regard ou quelle règle mobiliser. Ils accélèrent la sélection stimulus–réponse et diminuent l’ambiguïté. En motricité, orienter l’attention vers l’effet du geste (Cue externe) favorise une auto-organisation plus efficace et un contrôle moteur moins contraint, ce qui améliore la précision, l’économie d’effort et la rétention des habiletés. En cognition, un Cue associé à l’encodage d’une information sert d’indice de récupération en mémoire : plus il est diagnostique (pertinent et distinctif), plus la récupération est probable.
Typologie pratique des Cues pour l’enseignement et l’entraînement
- Cues visuels : cibles, flèches, zones colorées, paliers de hauteur, trajectoires dessinées.
- Cues auditifs : métronome, comptage rythmique, accent sonore déclencheur.
- Cues tactiles et proprioceptifs : tapes légères, textures, résistances élastiques.
- Cues verbaux : mots courts, métaphores, images mentales (ex. « ressort », « laser »).
- Cues temporels : rythme (battements, timing), pré-cues (avant l’action), concurrentiels (pendant), terminaux (après, sous forme de feedback)
Bonnes pratiques : privilégier des Cues brefs, concrets, externes, multimodaux quand c’est pertinent, et cohérents avec l’objectif (précision, amplitude, synchronisation). L’espacement des Cues (ne pas surcharger), la progression (du simple au complexe) et la spécificité contextuelle (Cues proches des conditions réelles) renforcent l’efficacité.
Cue et apprentissage moteur : ce que montrent les recherches
De vastes synthèses en contrôle moteur documentent que des Cues externes améliorent l’exactitude, la fluidité et la rétention, parfois dès la première séance. En parallèle, des Cues rythmiques (métronome, pulsation) soutiennent la synchronisation auditivo-motrice, utile pour la coordination, la vitesse de réaction et certaines habiletés séquentielles.
Les Cues de connaissance du résultat (KR) et de la performance (KP) — quand ils sont dosés et différés — optimisent la consolidation des apprentissages moteurs.
À retenir : orienter l’attention vers l’effet de l’action (et non vers les segments corporels) produit en général des gains plus stables et transférables.
Cue et mémoire : indices d’encodage et de récupération
En psychologie cognitive, le Cue agit comme indice de récupération : la probabilité de rappeler une information dépend de la compatibilité entre les Cues disponibles au moment du rappel et ceux présents lors de l’encodage. La spécificité de l’encodage explique pourquoi réviser dans des contextes variés (diversifier les Cues) favorise la généralisation. Des Cues multimodaux (image + mot + rythme par exemple) enrichissent la trace associative, améliorant l’accès ultérieur (Tulving & Thomson, 1973).
Cue, attention spatiale et préparation de la réponse
Dans les tâches d’orientation attentionnelle, un Cue prédictif (par ex. une flèche qui indique où va paraître le stimulus) accélère la réaction parce qu’il prépare le système attentionnel à la bonne place. Mais tous les Cues ne se valent pas : plus un Cue est fiable (fort taux de validité), plus on a tendance à lui faire confiance… et plus le coût est élevé lorsqu’il est trompeur (il oriente d’abord au mauvais endroit, obligeant à désengager, réorienter puis répondre, ce qui ralentit et augmente les erreurs). La saillance (capacité du signal à se détacher du fond — couleur, contraste, mouvement, son) aide à capter l’attention, mais elle doit rester alignée avec l’objectif : un Cue très saillant mais peu pertinent devient du bruit. En enseignement, on privilégiera donc des Cues pertinents et cohérents, en limitant les distractions (animations, flèches décoratives, consignes multiples) qui dispersent l’attention et dégradent la performance. (Posner, 1980)
Concevoir de bons Cues : principes clés transférables au terrain
Pour qu’un Cue soit vraiment opérationnel sur le terrain, il doit transformer l’attention en action efficace : des repères visibles mais sobres, pertinents et orientés vers l’effet posent les bases d’une exécution fluide et transférable.
- Saillance contrôlée : rendre le signal visible/audible sans saturer l’environnement.
- Pertinence diagnostique : un Cue doit prédire ce qui compte (cible, rythme, direction).
- Externalisation : formuler l’instruction centrée sur l’effet attendu.
- Rythme et timing : stabiliser la cadence avant d’augmenter la complexité.
- Fading (estompage) : réduire progressivement la fréquence/intensité des Cues pour encourager l’auto-régulation.
- Variabilité contextuelle : entraîner avec des Cues diversifiés pour favoriser le transfert.
En pratique, un Cue gagnant est bref, diagnostique, centré sur l’effet, s’appuie sur le rythme quand c’est utile, puis s’estompe au bon moment pour favoriser l’auto-régulation et le transfert en situations variées.
Limites, controverses et conditions de validité
Avant de généraliser l’usage des Cues, il est utile d’identifier ce qui peut réduire leur efficacité ou brouiller l’apprentissage selon les contextes et les publics.
- Sur-cueing : trop de Cues fragmentent l’attention et créent une dépendance au guidage.
- Cues internes : utiles ponctuellement pour corriger un pattern, mais parfois dégradent la fluidité s’ils focalisent excessivement sur les segments corporels.
- Transférabilité : des performances dopées par des Cues très spécifiques peuvent peu généraliser si les Cues ne sont plus présents.
- Variabilité individuelle : âge, profil cognitif, TND, niveau expert/débutant modulent l’effet ; tester–adapter reste essentiel.
- Débats scientifiques : les Cues externes sont généralement les plus efficaces, mais il existe des cas limites qui font débat (tâches très proprioceptives, débuts d’apprentissage, pathologies spécifiques). Côté mémoire, la spécificité de l’encodage ne suffit pas à tout expliquer : l’effet du contexte et les stratégies métacognitives (et leurs interactions) restent activement étudiés..
En résumé, des Cues brefs, pertinents et estompés progressivement, testés sur des situations variées et adaptés aux caractéristiques de l’apprenant, maximisent la rétention et le transfert tout en limitant la dépendance.
Pour aller plus loin :
-
Wulf, G. (2013). Attentional focus and motor learning: A review of 15 years. International Review of Sport and Exercise Psychology, 6(1), 77–104. https://doi.org/10.1080/1750984X.2012.723728
-
Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2019). Motor Learning and Performance (6th ed.). Human Kinetics. https://us.humankinetics.com/products/motor-learning-and-performance-6th-edition
-
Magill, R. A., & Anderson, D. (2021). Motor Learning and Control: Concepts and Applications (12th ed.). McGraw-Hill. https://www.mheducation.com/highered/product/motor-learning-control-magill-anderson/M9781260252720.html
-
Tulving, E., & Thomson, D. M. (1973). Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory. Psychological Review, 80(5), 352–373. https://doi.org/10.1037/h0020071
-
Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32(1), 3–25. https://doi.org/10.1080/14640748008400866
-
Easterbrook, J. A. (1959). The effect of emotion on cue utilization and the organization of behavior. Psychological Review, 66(3), 183–201. https://doi.org/10.1037/h0047707
-
Repp, B. H. (2005). Sensorimotor synchronization: A review of the tapping literature. Psychonomic Bulletin & Review, 12(6), 969–992. https://doi.org/10.3758/BF03206433
-
Shapiro, D. C. (2004). The external focus: A facilitative cue for motor learning. In Williams, A. M., & Hodges, N. J. (Eds.), Skill Acquisition in Sport (pp. 256–272). Routledge. https://www.routledge.com/Skill-Acquisition-in-Sport/Williams-Hodges/p/book/9780415334929
FAQ sur les Cues
Comment choisir entre Cue interne et Cue externe ?
Les Cues rythmiques (métronome, pulsations) sont-ils toujours utiles ?
Comment planifier l’estompage (fading) des Cues pour favoriser l’autonomie ?
Les Cues fonctionnent-ils de la même manière en mémoire et en motricité ?