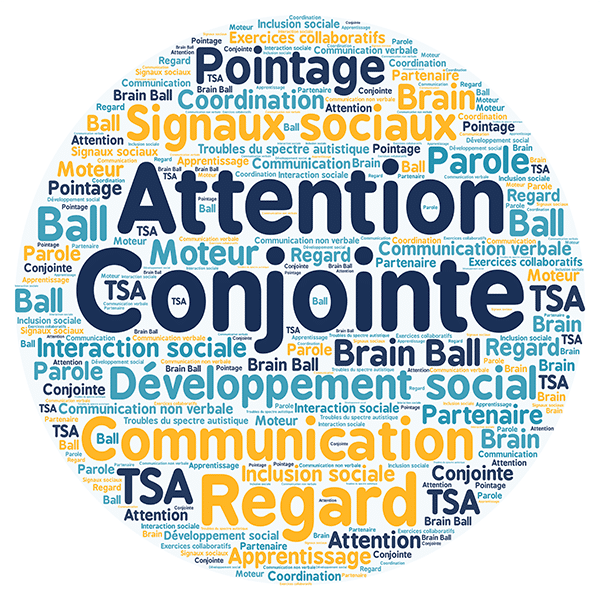Qu’est-ce que l’attention conjointe ?
L’attention conjointe désigne la capacité à partager une attention avec une autre personne sur un même objet, événement ou sujet. Elle implique que deux individus soient conscients de porter leur attention sur la même chose et qu’ils reconnaissent cette attention partagée.
Cette compétence émerge dès les premiers mois de vie et joue un rôle fondamental dans le développement des interactions sociales, du langage et de la cognition. En tant que psychomotricien, nous y portons une attention toute particulière, car elle reflète l’engagement dans une relation et prépare l’enfant à la communication symbolique.
Les trois composantes de l’attention conjointe
L’attention conjointe a été décrite de plusieurs façons selon les auteurs et les approches théoriques. Deux classifications principales se complètent :
• Une approche fonctionnelle : orientation, coordination et intention de partager
Certains chercheurs en psychologie du développement (Golse, 2020 ; Rogé, 2008) considèrent que l’attention conjointe repose sur trois piliers essentiels :
- L’orientation de l’attention : la capacité de suivre le regard ou le geste d’un autre vers un objet ou un événement.
- La coordination des regards : l’alternance entre le regard porté sur l’objet et le regard vers l’interlocuteur, pour établir un lien.
- L’intention de partager : la volonté de montrer quelque chose à l’autre, avec une véritable valeur communicative.
Cette approche met en lumière les dimensions motrices (regards, gestes), cognitives (compréhension de l’intention de l’autre) et affectives (désir de lien social).
• Une approche expérimentale : initiation, réponse et maintien
D’autres auteurs, en particulier dans les travaux de recherche expérimentale (Bakeman & Adamson, 1984 ; Mundy & Newell, 2007), distinguent plutôt trois étapes observables lors d’une interaction :
- L’initiation : lorsqu’un individu dirige volontairement son attention vers un objet (par un geste, un regard) pour inviter l’autre à le suivre.
- La réponse : lorsque l’autre suit ce geste ou ce regard, et oriente son attention vers l’objet désigné.
- Le maintien : lorsque les participants alternent entre l’objet et l’interlocuteur, pour vérifier que l’attention est bien partagée.
Cette approche insiste sur la séquence d’actions observables et sert souvent de base aux évaluations cliniques et expérimentales (par ex. tests d’eye-tracking).
• Deux visions complémentaires
Ces deux modèles ne s’opposent pas, mais décrivent l’attention conjointe sous deux angles différents :
- l’un insiste sur les mécanismes internes (motricité, cognition, affectivité),
- l’autre sur les manifestations extérieures observables (initier, répondre, maintenir).
En les combinant, on obtient une vision plus complète de cette compétence fondamentale, au cœur du développement social, de la communication et du langage chez l’enfant.
Fonctionnements psychologiques et phénoménologiques
Au-delà des descriptions fonctionnelles ou expérimentales, certains auteurs abordent l’attention conjointe sous un angle plus psychologique et phénoménologique.
Une approche phénoménologique considère l’attention conjointe comme une attention “mutuellement manifeste” : les deux participants savent, au moins tacitement, que leur regard ou leur focalisation est partagé (Bimbenet, 2010). Autrement dit, ce n’est pas seulement voir ensemble, c’est savoir ensemble.
Dans une perspective plus théorique et développementale, des auteurs comme Winnicott, Bruner ou Golse soulignent que l’attention conjointe contribue à la construction d’un espace mental partagé. Elle constitue un socle pour l’intersubjectivité et prépare l’accès à la communication symbolique, en permettant à l’enfant de comprendre que son expérience peut être reconnue et partagée avec autrui.
Le développement de l’attention conjointe chez l’enfant
L’attention conjointe apparaît généralement entre 9 et 12 mois, avec des variations selon les enfants. On distingue plusieurs étapes dans son développement :
-
- Avant 6 mois : l’enfant répond à des stimulations sociales, mais ne coordonne pas encore son attention avec autrui.
- Vers 6-9 mois : il commence à suivre le regard ou le pointage d’un adulte, sans nécessairement comprendre l’intention communicative.
- Entre 9 et 12 mois : l’enfant suit activement le pointage, regarde successivement l’objet et l’adulte. Il commence à initier lui-même des épisodes d’attention conjointe.
- Vers 12-18 mois : ces échanges deviennent plus fréquents et servent de base à l’apprentissage du langage et des interactions complexes.
L’attention conjointe est perçue comme un socle du développement social et cognitif :
- elle est un précurseur du pointage, de l’intentionnalité partagée et du langage (Mundy & Newell, 2007).
- elle contribue à l’intersubjectivité, c’est-à-dire la capacité à comprendre que l’autre a ses propres perceptions, pensées, intentions.
- elle est souvent déficiente ou altérée dans des troubles comme l’autisme, ce qui en fait un indicateur de l’empan social précoce (Rogé, 2008 ; Golse, 2020)
Enjeux pour la communication et l’apprentissage
L’attention conjointe est considérée comme un prérequis essentiel à l’acquisition du langage et aux apprentissages sociaux. Elle ouvre la voie à plusieurs compétences clés :
- Apprentissage du vocabulaire : en associant de nouveaux mots à des objets ou événements regardés ensemble, l’enfant comprend plus facilement leur signification.
- Compréhension des intentions : partager un même point d’attention permet d’accéder à l’intention de l’autre, de décoder ses gestes ou son discours.
- Organisation des échanges sociaux : elle aide l’enfant à se repérer dans les interactions, à comprendre qui s’adresse à qui, et à saisir le sujet de la conversation.
Chez les enfants au développement typique, l’attention conjointe prépare la communication symbolique (langage, jeu d’imagination, conversations structurées) et contribue à l’intersubjectivité, c’est-à-dire la conscience d’un monde partagé avec autrui.
Chez les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou d’autres troubles du développement, cette compétence est souvent altérée. Or, les recherches montrent que la stimulation précoce de l’attention conjointe améliore non seulement la qualité des interactions sociales, mais aussi les apprentissages langagiers, la capacité d’imitation et l’engagement relationnel (Mundy et al., 2007).
L’attention conjointe dans le TSA
Chez les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme, l’attention conjointe est souvent perturbée, tant dans la capacité à répondre qu’à initier des épisodes d’attention partagée.
Les recherches ont montré que le déficit d’attention conjointe est l’un des marqueurs précoces du TSA, observable dès la fin de la première année de vie (Mundy et al., 2007). Ces enfants peuvent par exemple :
- Ne pas suivre le regard ou le pointage d’un adulte
- Ne pas montrer d’objet de manière spontanée
- Avoir du mal à établir un contact visuel coordonné
Ces difficultés peuvent limiter le développement du langage, de l’imitation, de l’empathie et de la compréhension sociale. En psychomotricité, tout l’enjeu est de soutenir cette compétence en proposant des médiations adaptées, ludiques et engageantes.
> Lire à ce sujet, notre article : Autisme et communication : comment faciliter les échanges ?
Soutenir l’attention conjointe en psychomotricité
L’approche psychomotrice privilégie le corps en mouvement, la relation et le jeu comme leviers pour développer les compétences sociales et communicationnelles. L’attention conjointe, parce qu’elle se situe à l’articulation du regard, du geste et de l’intention, peut être stimulée de manière naturelle au sein de la relation thérapeutique.
Pour la favoriser, plusieurs modalités sont particulièrement efficaces :
1. Utiliser des objets médiateurs
Des balles, instruments de musique, peluches ou objets lumineux peuvent être présentés et manipulés en duo. L’objet joue alors le rôle de tiers qui attire l’attention, facilite le partage et devient support de l’échange.
2. Proposer des jeux de tour de rôle
Des activités simples où chacun attend son tour encouragent l’alternance des regards et des gestes, tout en renforçant l’imitation mutuelle et le plaisir de la réciprocité.
3. Mettre en place des routines rythmées
Des chansons à gestes, des exercices en musique ou des jeux de balancement offrent une structure prévisible. Ils facilitent l’anticipation, renforcent l’attention auditive et soutiennent la coordination avec autrui.
4. Offrir un cadre sécurisant
Un espace calme, visuellement structuré et organisé dans le temps (planning visuel, repères fixes) aide l’enfant à canaliser son attention, tout en réduisant les distracteurs sensoriels et émotionnels.
Ainsi, l’attention conjointe est sollicitée et renforcée non pas par des injonctions ou des contraintes, mais par le plaisir partagé dans l’action. C’est ce plaisir qui favorise l’engagement, la répétition des expériences et, in fine, l’intégration de cette compétence fondamentale dans la vie quotidienne.
L’attention conjointe et le Brain Ball
La méthode Brain Ball mobilise de manière naturelle l’attention conjointe, car elle associe mouvement, objets médiateurs et interactions sociales. Les balles utilisées deviennent des supports de focalisation partagée : elles captent l’attention, circulent entre les participants et nécessitent une coordination de regards, de gestes et d’intentions.
Chaque exercice de Brain Ball stimule ainsi :
- L’orientation de l’attention : suivre la trajectoire d’une balle, anticiper son mouvement.
- La coordination des regards : alterner entre la balle et le partenaire qui la lance ou la rattrape.
- L’intention de partager : envoyer la balle à l’autre est déjà une invitation à entrer dans une interaction conjointe.
En psychomotricité, ces activités sont particulièrement adaptées pour soutenir le développement des enfants, favoriser la communication dans le cas de troubles du spectre autistique, et enrichir les compétences sociales de manière ludique et engageante.
Le Brain Ball illustre parfaitement comment le jeu corporel et la médiation par l’objet peuvent devenir un outil privilégié pour renforcer l’attention conjointe, au service du langage, de la cognition et du lien social.
Pour aller plus loin :
- Mundy, P., Sigman, M., & Kasari, C. (1990). A longitudinal study of joint attention and language development in autistic children. Journal of autism and developmental disorders, 20(1), 115–128. https://doi.org/10.1007/BF02206861
- Bastier, C. (2019). Faciliter la communication et le développement sensoriel des personnes avec autisme. Dunod.
FAQ sur l’attention conjointe
À quel âge apparaît l’attention conjointe ?
L’attention conjointe émerge entre 9 et 12 mois chez la plupart des enfants. Elle se développe ensuite de façon plus complexe jusqu’à 18 mois, devenant un socle pour le langage et les relations sociales.
Pourquoi l’attention conjointe est-elle importante pour le langage ?
Elle permet à l’enfant d’associer un mot à un objet ou une action en contexte partagé. L’enfant apprend que les mots sont liés à des choses que l’on regarde ensemble, ce qui est essentiel pour l’acquisition du vocabulaire.
Comment repérer un déficit d’attention conjointe ?
Un enfant qui ne suit pas le regard ou le geste d’un adulte, qui ne montre pas spontanément des objets, ou qui évite les échanges de regard au-delà de 12 mois, peut présenter un déficit. Cela nécessite une observation fine et éventuellement une évaluation spécialisée.
Peut-on améliorer l’attention conjointe ?
Oui, à travers des jeux interactifs, des médiations corporelles ou ludiques, et une posture relationnelle ajustée. La psychomotricité, l’orthophonie ou les approches éducatives structurées peuvent apporter un soutien ciblé.