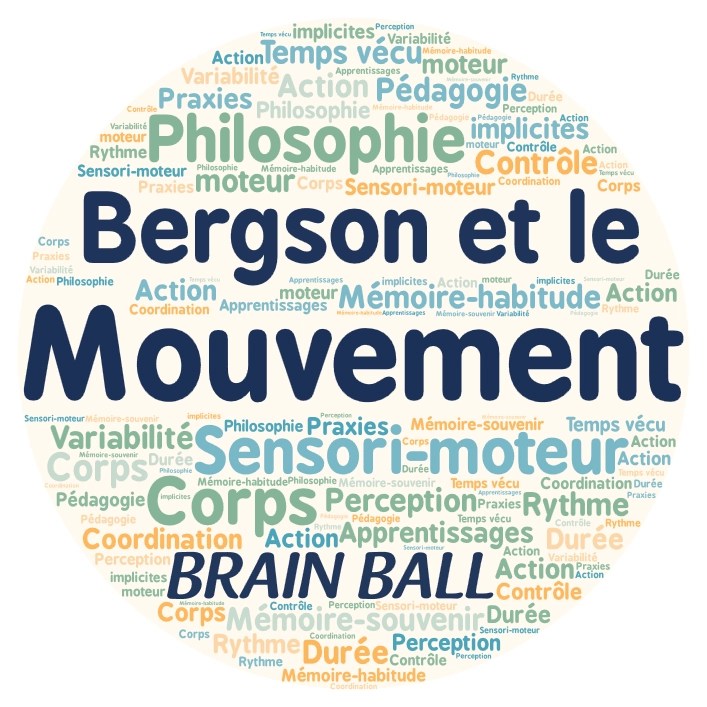Henri Bergson (1859–1941) est souvent présenté comme le philosophe de la durée, ce temps vécu qualitatif qui déborde le temps homogène de l’horloge. Mais lire Bergson et le mouvement, c’est aussi reconnaître une philosophie du corps en action : la perception n’est pas contemplation mais préparation à agir, la mémoire n’est pas un stock inerte mais une ressource qui oriente l’activité présente, et le temps d’une séance n’est pas seulement mesurable — il est sculpté. Cette perspective rejoint les préoccupations des éducateurs, des thérapeutes et des intervenants sport-santé : comment organiser la progression, stabiliser des coordinations, mobiliser l’attention, et faire de chaque tâche un milieu d’action où l’on apprend « par » le mouvement. Sans confondre philosophie et neurosciences, la philosophie du mouvement chez Bergson propose un langage opératoire pour concevoir des dispositifs où la qualité du geste compte autant que la quantité de répétitions.
Notions clés : durée, intuition, mémoire — les appuis d’une pédagogie incarnée
Aborder Bergson et le mouvement, c’est reconnaître trois repères fondamentaux qui constituent un socle conceptuel utile.
- La durée
Elle est continue, élastique, faite de dilatations et de contractions. En pédagogie motrice, cela invite à travailler la continuité d’un enchaînement plutôt que la simple addition de « temps forts » isolés. La durée d’une séquence Brain Ball se ressent dans le liant entre consignes, transitions et reprises : c’est là que se gagne la fluidité.
- L’intuition
Chez Bergson, elle n’est pas impression vague mais méthode pour entrer dans un devenir et saisir ses qualités. Transposée aux apprentissages, elle autorise l’enseignant à ajuster une tâche en fonction d’indices qualitatifs (tonus, régularité rythmique) plutôt que de se limiter à des indicateurs quantitatifs tels que la vitesse d’exécution ou le nombre de répétitions.
- La mémoire
Bergson distingue la mémoire-habitude (gestes incorporés par la répétition) et la mémoire-souvenir (évocation d’images ou d’épisodes). L’une stabilise des praxies ; l’autre oriente l’action par de rappels brefs (image motrice, indice verbal) au bon moment. Conjuguer les deux permet de gagner en aisance sans perdre en intelligibilité du geste.
Corps, perception et action : une continuité sensorimotrice au service du geste
Dans Matière et mémoire, Bergson soutient que le corps est un centre d’action qui sélectionne dans le réel ce qui est utile à la réponse motrice. Percevoir une balle qui arrive, ce n’est pas simplement la regarder comme une image neutre, comme « une sphère colorée en mouvement » ; c’est amorcer des ajustements posturaux, une anticipation de trajectoire, une préparation musculaire.
Autrement dit, Bergson rejoint l’intuition moderne selon laquelle la perception est orientée par les possibilités d’agir : voir, c’est déjà pressentir ce que l’on peut faire — attraper, éviter, renvoyer. La perception n’est donc jamais passive ; elle est immédiatement pratique, enracinée dans l’action à venir. Ce cadrage éclaire des choix pédagogiques concrets : changer d’appuis, ralentir la cadence, déplacer la pulsation ne modifie pas seulement la difficulté ; cela recompose ce que l’élève perçoit, ce qu’il comprend et la manière dont il s’engage dans la tâche.
La durée comme architecture du temps d’apprentissage
Bergson incite à penser une séance comme une phrase plutôt qu’une juxtaposition de notes isolées. Ce qui compte n’est pas seulement la succession des exercices, mais le liant qui leur donne continuité et sens. La pulsation stable joue ici un rôle décisif : elle offre une structure fixe, comme un cadre commun, tout en fonctionnant comme un élastique du temps vécu. Autrement dit, le rythme est constant, mais la perception qualitative de la durée varie selon la manière dont le mouvement s’y inscrit.
Trop rapide, le geste se crispe et perd sa souplesse ; trop lent, l’élan s’éteint et la concentration se dissout. En Brain Ball, par exemple, une même pulsation musicale peut soutenir soit une frappe à chaque temps (effet contracté, densité et énergie), soit une frappe tous les deux temps (effet étiré, amplitude et respiration).
La progression se mesure alors moins au nombre de répétitions qu’à la qualité des transitions : entrer dans l’activité, la maintenir, la relancer, puis revenir au calme. Dans cette perspective, le rythme musical et corporel n’est pas un simple décor, mais une véritable architecture temporelle qui oriente l’attention, stabilise la coordination et structure l’expérience de l’apprentissage.
Mémoire-habitude et souvenir : articuler consolidation et intelligence de l’action
Avec Bergson, il ne s’agit pas d’opposer automatisme et compréhension, mais de comprendre comment mémoire-habitude et mémoire-souvenir coopèrent dans l’action. Pour Bergson, la mémoire n’est pas uniforme : elle se décline en deux registres complémentaires :
- La mémoire-habitude correspond aux gestes incorporés par la répétition : une fois intégrés, ils ne demandent plus une attention constante, ce qui libère des ressources pour d’autres aspects de l’action. Elle allège donc la charge mentale en stabilisant des coordinations de base — comme tenir un rythme, enchaîner un pas ou jongler sans réfléchir à chaque mouvement.
- La mémoire-souvenir, quant à elle, n’est pas mécanique mais évocatrice. Elle permet d’orienter l’action grâce à de micro-rappels : une image motrice, un mot-clé, une sensation réactivée au bon moment. Ainsi, un simple « relâche l’épaule », « regarde la cible » ou « reste en rythme » suffit à corriger ou à enrichir le geste en cours sans rompre sa continuité.
En Brain Ball, une séance efficace combine ces deux dimensions. Les routines (installer un pattern rythmique, répéter un enchaînement, fluidifier une praxie) consolident les bases et donnent de la stabilité. Mais les variations (changer l’amplitude, inverser la latéralité, modifier la cadence) réactivent la mémoire-souvenir, évitant que l’habitude ne devienne rigidité. C’est cette alternance qui maintient l’adaptabilité : l’habitude soutient le geste, tandis que la compréhension fine guide son ajustement.
Convergences actuelles : Bergson et la sensorimotricité, sans anachronisme
On pourrait lire Bergson et la sensorimotricité comme une anticipation des approches enactives et de la théorie sensorimotrice. L’énaction désigne l’idée que la cognition n’est pas un traitement abstrait d’informations, mais une activité « mise en acte » : percevoir, c’est déjà agir, et l’action transforme en retour la manière de percevoir. Cette conception rejoint la philosophie bergsonienne, pour qui le corps sélectionne dans le réel ce qui est utile à l’action et inscrit la conscience dans un temps vécu, processuel.
Les convergences existent donc : la perception est orientée vers l’action, l’expérience est située dans un environnement concret, et la conscience du temps se construit comme un flux continu plutôt que comme une succession de points mesurables. Mais il faut éviter de forcer l’analogie : les théories contemporaines de l’énaction reposent sur des protocoles expérimentaux précis (contrôle moteur, intégration multisensorielle, apprentissage implicite) que Bergson n’avait pas.
Sa valeur aujourd’hui n’est donc pas scientifique au sens strict, mais conceptuelle. Il fournit une grammaire philosophique robuste pour penser le lien entre mouvement, perception et apprentissage. Ce cadre légitime la mise en place de dispositifs pédagogiques centrés sur l’agir, qu’il s’agit ensuite d’articuler avec des indicateurs observables — fluidité du geste, régularité rythmique, stabilité posturale, disponibilité attentionnelle.
Ce que Bergson change dans le regard professionnel
Le premier déplacement concerne la qualité : une séance ne se réduit pas à un « remplissage » d’exercices ou de temps, elle se conçoit comme un flux continu. Le liant entre les moments devient un objectif en soi, car c’est lui qui donne cohérence et fluidité à l’expérience.
Le deuxième déplacement touche l’observation : il ne s’agit pas seulement de compter les réussites ou d’évaluer la performance finale, mais d’apprendre à lire des signaux qualitatifs tels que le tonus, la direction du regard, l’équilibre ou l’élan. Ces indices subtils renseignent sur l’engagement du participant et guident les ajustements en temps réel.
Le troisième concerne la progression : répéter n’a de valeur que si la répétition « épaissit » la durée, c’est-à-dire qu’elle densifie la présence au geste. Ce n’est pas la quantité brute de répétitions qui fait progresser, mais la manière dont elles construisent une continuité signifiante et renforcent la disponibilité motrice et cognitive.
Enfin, le quatrième déplacement touche à l’attention : loin d’être une ressource figée que l’on répartirait en parts limitées, elle se travaille comme une forme temporelle. Elle peut être modelée par la cadence, la variabilité réglée des exercices et des transitions soignées. Ce pilotage du temps attentionnel constitue en lui-même une philosophie de l’action : organiser la durée pour permettre à chacun de se maintenir présent au geste, sans crispation ni dispersion.
Limites et débats : vitalisme, cerveau-filtre et statut de la durée
Lire Bergson et le mouvement aujourd’hui suppose aussi de reconnaître les limites de son cadre philosophique. Certaines de ses intuitions, qui avaient une force à son époque, ne peuvent pas être reprises telles quelles. L’élan vital, par exemple, qu’il invoquait pour expliquer la créativité du vivant, reste une notion poétique mais contestée en biologie. Son idée d’un cerveau-fitre, qui laisserait simplement passer les perceptions au lieu de produire les états mentaux, est davantage une hypothèse spéculative qu’une donnée scientifique. Quant à la durée, elle ne décrit pas un temps neuronal mesurable comme le font les neurosciences, mais une expérience vécue, subjective, qui ne peut pas être réduite à des chiffres.
Ces réserves n’annulent pas son intérêt, mais appellent à la prudence : on ne transpose pas Bergson comme une théorie scientifique, on l’utilise comme une boîte à outils conceptuelle. Ses repères — perception orientée vers l’action, mémoire-habitude, continuité qualitative du geste — fournissent un langage pour penser la pratique. Les effets, eux, doivent être évalués avec des indicateurs observables : régularité rythmique, précision gestuelle, endurance attentionnelle. C’est cette articulation entre philosophie et données concrètes qui rend la démarche crédible et transmissible.
Conclusion : pourquoi inscrire Bergson et le mouvement au coeur du glossaire Brain Ball ?
La valeur de Bergson n’est pas d’offrir une théorie concurrente des neurosciences, mais d’apprendre à penser le corps qui apprend. En réinscrivant la perception dans l’action, la mémoire dans l’orientation de l’acte, et le temps dans une continuité qualitative, il fournit aux praticiens une boussole : rythmer pour libérer le geste, varier pour stabiliser l’habitude, qualifier pour faire progresser.
Dans une séance de Brain Ball, cela signifie que l’on ne cherche pas seulement à multiplier les exercices ou les répétitions, mais à donner une cohérence à la durée vécue, à prêter attention à la qualité du geste et à la manière dont l’élève s’engage dans l’action. Organiser un enchaînement, ménager des transitions, introduire des variations mesurées : autant de choix pédagogiques qui traduisent concrètement une philosophie du mouvement.
La réflexion de Bergson sur le mouvement contribue ainsi à une éducation incarnée, où l’on fait penser en bougeant et bouger en pensant — l’ambition même du Brain Ball. Elle rappelle que le corps n’est pas seulement un instrument à entraîner, mais un milieu vivant d’apprentissage, où la perception, la mémoire et le temps s’entrelacent pour soutenir le développement moteur, cognitif et attentionnel.
Note de classement : Cet article est rattaché à la catégorie Théories et modèles de référence. En effet, plutôt qu’une biographie de Bergson, il propose une lecture de sa pensée appliquée au mouvement et à l’apprentissage corporel. L’objectif est de montrer comment ses concepts — durée, mémoire, intuition, perception-action — offrent un cadre de référence utile pour concevoir et analyser des pratiques pédagogiques comme le Brain Ball.
Pour aller plus loin :
-
Bergson, H. (1889). Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris: Félix Alcan. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1520945m
-
Bergson, H. (1896). Matière et mémoire : Essai sur la relation du corps à l’esprit. Paris: Félix Alcan. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3045238c
-
Bergson, H. (1907). L’Évolution créatrice. Paris: Félix Alcan. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k991406s
-
Lawlor, L. (2021). Henri Bergson. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/bergson/
-
Dainton, B. (2018). Temporal Consciousness. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/consciousness-temporal/
-
O’Regan, J. K., & Noë, A. (2001). A sensorimotor account of vision and visual consciousness. Behavioral and Brain Sciences, 24(5), 939–1031. Préprint: https://www.rctn.org/bruno/mindmachine/oregan.pdf
-
Noë, A. (2004). Action in Perception. Cambridge, MA: MIT Press. https://mitpress.mit.edu/9780262640633/action-in-perception/
-
Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (2017). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience (Revised ed.). Cambridge, MA: MIT Press. https://mitpress.mit.edu/9780262529365/the-embodied-mind/
-
Seibt, J. (2012). Process Philosophy. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/process-philosophy/
-
Annales bergsoniennes IV. (2015). Les théories de Bergson sur la perception, la mémoire et les neurosciences cognitives modernes (pp. 163–178). Paris: PUF. Extrait : https://shs.cairn.info/annales-bergsoniennes-iv–9782130572305-page-163
-
Morange, M. (2013). Un retour du vitalisme ? Histoire de la recherche contemporaine, 2(3). https://journals.openedition.org/hrc/316
-
Bergson, H. (1911/2009). Matter and Memory (trans. N. M. Paul & W. S. Palmer). Brock University Mead Project (Ch. 1 & 3). https://brocku.ca/MeadProject/Bergson/Bergson_1911b/Bergson_1911_01.html ; https://brocku.ca/MeadProject/Bergson/Bergson_1911b/Bergson_1911_03.html
-
Ward, D., Silverman, D., & Villalobos, M. (2017). Introduction: The varieties of enactivism. Topoi, 36(3), 365–375. https://link.springer.com/article/10.1007/s11245-017-9484-6
-
Glenberg, A. M. (1997). What memory is for. Behavioral and Brain Sciences, 20(1), 1–55. https://doi.org/10.1017/S0140525X97470012
-
Gallese, V., & Lakoff, G. (2005). The brain’s concepts: The role of the sensory-motor system in conceptual knowledge. Cognitive Neuropsychology, 22(3–4), 455–479. https://doi.org/10.1080/02643290442000310
FAQ sur Bergson et le mouvement
En quoi comprendre Bergson et le mouvement peut-il enrichir une séance d’activité physique ?
Bergson remet l’action au centre : la tâche doit donc proposer des possibilités d’agir claires qui reconfigurent la perception. En jouant sur la pulsation et les variations de cadence, on sculpte la durée de l’apprentissage. L’élève gagne en fluidité et en présence au geste, au-delà des seuls scores.
La distinction mémoire-habitude et mémoire-souvenir est-elle utile en pratique ?
Oui, car elle articule consolidation automatique et orientation consciente. On alterne des routines qui stabilisent les coordinations et de brèves préactivations (images motrices, indices) qui guident l’action. Ce couple optimise l’efficience et la stabilité des acquisitions.
Bergson anticipe-t-il les théories sensorimotrices actuelles ?
Il en partage l’intuition majeure — la perception comme maîtrise de lois sensori-motrices — mais ne fournit pas de modèles expérimentaux. L’usage pertinent consiste à articuler l’éclairage bergsonien avec les données du contrôle moteur, de l’attention et de l’apprentissage implicite.
Quelles précautions pour éviter l’anachronisme ?
Il convient de ne pas attendre de Bergson ce qu’il ne propose pas : ni théorie neuroscientifique, ni protocole expérimental. Son apport doit être mobilisé comme un cadre conceptuel pour concevoir et analyser des situations d’apprentissage centrées sur le corps en mouvement. L’évaluation de leur efficacité repose ensuite sur des indicateurs observables et simples — régularité rythmique, stabilité posturale, précision gestuelle, constance attentionnelle. Autrement dit, on articule une orientation philosophique (pour penser et structurer) à des mesures opérationnelles (pour vérifier et ajuster), sans les confondre. Cette distinction garantit la rigueur et évite l’anachronisme.