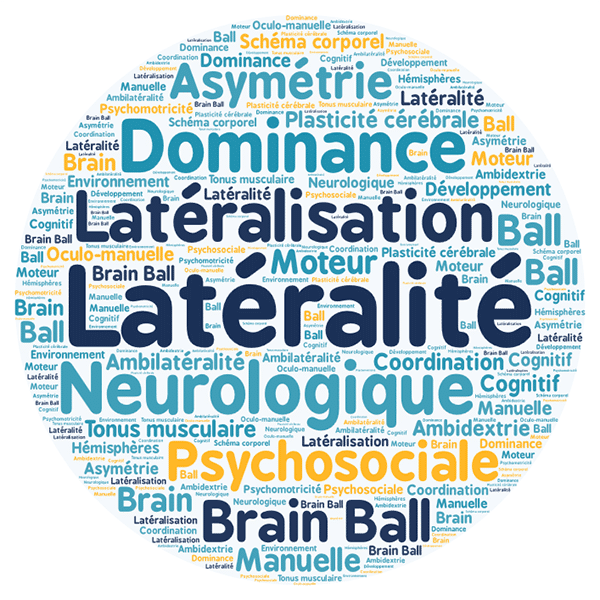La latéralité se définit comme la préférence d’utilisation asymétrique des différentes parties du corps, telles que la main, l’œil, le pied, ou même l’oreille, dans le but d’être efficace dans les activités motrices quotidiennes. Le processus dynamique qui mène à une latéralité mature, appelé latéralisation, est influencé par différents facteurs internes (génétique, neurologique…) et externes (influence socioculturelle, les apprentissages…).
Il dépend à la fois de la maturation neurologique permettant la dominance d’un des deux hémisphères cérébraux et des expériences motrices de l’enfance grâce à la plasticité cérébrale. Dès ses premiers mois, le bébé commence à différencier un côté « porteur » du corps et un côté « explorateur ». Par exemple, lorsqu’il est allongé sur le ventre, il utilise un bras pour soutenir son torse et l’autre main pour saisir et manipuler des objets.
Les étapes de la maturation de la latéralité
La latéralité manuelle se stabilise généralement autour de sept à huit ans, après plusieurs phases d’instabilité et de préférence. La dominance pédestre se manifeste avant deux ans, et la latéralité oculaire se développe vers deux ans et demi.
Les différents types de latéralité
Différents types de latéralité peuvent être distingués :
• La latéralité gestuelle innée
Elle est spontanée et dépend de la latéralité neurologique. Elle n’est influencée ni par l’environnement ni par un apprentissage. C’est durant les activités motrices que le côté préférentiel de la personne est mis en lumière.
• La latéralité usuelle ou fonctionnelle
C’est la latéralité du quotidien. Elle est soumise aux apprentissages et aux adaptations face à l’environnement : disposition des couverts sur la table, des stylos sur le bureau… Elle concerne différentes parties du corps comme les mains, les pieds, les yeux.
• La latéralité neurologique, tonique ou d’équipement
Elle est exprimée par le tonus de fond et d’action. En 2006, Vaivre-Douret décrit une latéralité tonique harmonieuse par des ballants et des extensibilités plus faibles des membres supérieurs directeurs et inversement des membres inférieurs non directeurs car en appui.
• La latéralité psychosociale
Elle fait référence aux gestes du quotidien influencés par des habitudes sociales et culturelles.
Les différents termes pour qualifier la latéralité…
La latéralité peut être qualifiée de plusieurs façons :
• Homogène : Lorsque les membres directeurs (œil, main, pied) sont du même côté du corps.
• Hétérogène ou croisée : Lorsque la préférence de latéralité est différente d’un côté à l’autre (par exemple, un œil gauche et une main droite).
• Discordante : Lorsque la latéralité usuelle diffère de la latéralité neurologique innée.
• Contrariée : Lorsque le choix de la main ou du membre directeur est influencé par une pression sociale ou environnementale.
• De nécessité : Lorsque l’utilisation d’un membre directeur devient contrainte suite à un accident (AVC, amputation, etc.).
• L’ambidextrie se définit par des capacités équivalentes dans l’exécution de gestes quotidiens entre les deux côtés des membres supérieurs.
• L’ambilatéralité est l’absence de préférence d’utilisation d’un côté lors de la réalisation d’une tâche. À la différence de l’ambidextrie, les deux mains n’ont pas la même efficience.
La latéralité et son impact sur le développement psychomoteur
La latéralité et la construction de l’espace
Grâce à l’asymétrie des membres directeurs, l’enfant va réussir à comprendre, à s’orienter et à organiser l’espace autour de lui en se basant sur ses propres repères corporels. Par exemple, un droitier voulant tourner à droite, peut s’appuyer sur la main qui écrit pour reconnaître dans quelle direction aller.
La latéralité et le tonus musculaire
Lorsque la latéralité est homogène, la régulation tonique est harmonieuse. Dans le cas contraire, on peut retrouver différents déséquilibres comme des tensions excessives dans différentes parties du corps (trapèzes, bassin, la crampe de l’écrivain…)
La latéralité et la coordination oculo-manuelle
La personne ayant une latéralité fixée et harmonieuse pourra exécuter de manière efficiente des activités motrices en utilisant directement sa main, son pied ou son oeil directeur.
La latéralité et la connaissance du schéma corporel
L’enfant va améliorer la connaissance et l’utilisation de son corps grâce aux observations de ses asymétries corporelles. Par exemple l’enfant va devoir prendre conscience des orientations différentes de ses pieds gauche et droit afin de chausser convenablement. De même à force d’exploration motrice, il constatera qu’il a un meilleur équilibre sur une jambe que sur l’autre, une meilleure prise de l’objet avec une main plutôt qu’avec l’autre, etc…
La latéralité est d’autant plus corrélée au schéma corporel et à l’organisation spatiale, que simultanément à la fixation de la latéralité, l’enfant acquiert la reconnaissance droite/gauche sur autrui, qu’il soit à côté ou en miroir.
Troubles de la latéralisation : comprendre les difficultés
Les troubles de la latéralisation font référence à un processus incomplet ou inadapté de latéralisation. Ces troubles sont souvent identifiés lorsqu’il y a une discordance entre la latéralité neurologique et la latéralité usuelle, impactant ainsi les compétences neuromotrices et cognitives.
Des études révèlent que ces troubles sont fréquemment associés à d’autres difficultés, comme le Trouble des Coordinations, des troubles de la régulation tonique, des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (dyslexie, dyscalculie, etc.), ainsi que des troubles de l’écriture (dysgraphie).
Dans le cadre des apprentissages fondamentaux, l’impact de la latéralité est importante. Ainsi par exemple, pour l’écriture et la lecture, la latéralité influence la discrimination des lettres miroirs comme b/d, u/n. Elle influence également le contrôle inhibiteur (voir notre article sur l’intérêt de renforcer le contrôle inhibiteur chez les enfants). C’est pourquoi, pour les enfants dont la latéralité n’est pas encore stabilisée, une prise en charge psychomotrice spécialisée peut s’avérer nécessaire.
Le Brain Ball : Un outil pour soutenir la latéralisation
La pratique régulière du Brain Ball aide à la différenciation et à l’utilisation des côtés droit et gauche du corps. Grâce à son système de code couleur, aux consignes variées et à l’adaptation en fonction du nombre de participants, le Brain Ball permet aux individus de mieux contrôler l’utilisation de leurs deux hémicorps.
Durant les exercices, chaque participant apprend à ajuster ses gestes en fonction des appuis au sol, de la main directrice, de la main de soutien et de l’œil directeur.
L’ajout d’une cadence permet d’automatiser l’utilisation des membres supérieurs en synchronisation avec le rythme, favorisant ainsi la spontanéité et l’efficacité des gestes, tout en réduisant l’implication cognitive qui pourrait freiner l’intégration du processus de latéralisation.
En savoir plus
• Carric, J.C. (2001). Lexique du psychomotricien. Vernazobres-Grego : Paris.
• Vaivre-Douret, L. (2006). Batterie d’Évaluations des Fonctions Neuro-Psychomotrices de l’enfant : NP-Mot. Paris : ECPA.
FAQ sur la notion de Latéralité
Qu’est-ce que la latéralité ?
À quel âge se met en place la latéralité ?
Pourquoi la latéralité est-elle importante pour les apprentissages ?
Le Brain Ball© favorise-t-il la latéralité ?